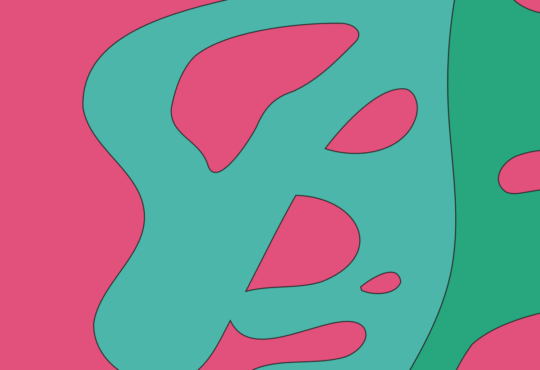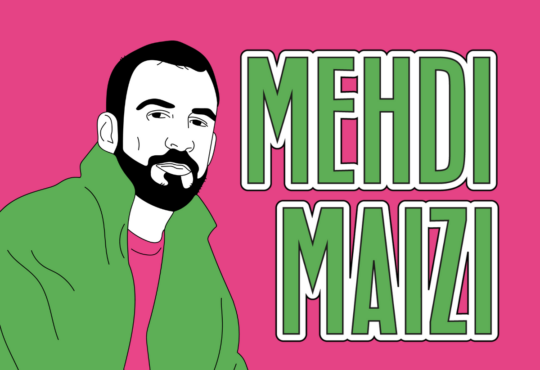Poids lourd de la formation en Afrique, Karel Brokken est le directeur de la West African football academy, dont le travail fait référence au Ghana. De passage en Côte d’Ivoire, le truculent manager Belge s’est assis pendant de longues heures autour d’un café pour raconter quatre décennies d’aventures africaines. Dans cette seconde partie, on parle République démocratique du Congo, mai 68 et oeufs meurettes. Par Christophe Gleizes et Julien Duez.
Vous vous souvenez de votre premier jour en Afrique ?
Ah, je m’en souviens comme si c’était hier. C’était le 5 juin 1985. Quand je suis arrivé à Kinshasa, je suis descendu dans les quartiers et je suis aller voir les enfants jouer. C’était comme quand j’étais petit. Nous aussi en Belgique on jouait au foot jour et nuit, on s’affrontait entre quartiers… Les études on s’en foutait, on voulait tous être footballeurs. J’habitais dans une petite cité, à Saint-Nicolas, on était une vingtaine de garçons à jouer tout le temps, et parmi cette vingtaine, il y en a douze qui ont par la suite joué en première division belge. A l’époque, on avait pas grand chose nous non plus. On avait un terrain qui était recouvert de sable. On s’entraînait deux fois par semaine avec un ballon dur comme du bois, tu peux pas t’imaginer. Je jouais avec des chaussures qui avaient une coque en acier… Bref, j’ai retrouvé cette ambiance dans les ghettos de Kinshasa, et ça m’a plu. Je suis tombé amoureux tout de suite. Ici, on se sent libre.
.Pourquoi avez-vous quitté la Belgique ?
J’avais terminé ma carrière de joueur, et je cherchais de nouvelles aventures. C’était pas une grosse carrière, hein. A l’époque, dans les années 70, le professionnalisme n’existait pas. Il y avait rien à gagner si tu jouais pas pour Anderlecht ou le Standard. Moi j’ai commencé à jouer pour le Berchem Sport, en première division. J’étais milieu gauche. En parallèle, j’étais cuisinier dans un restaurant. Sur la fin je suis allé au Maccabi d’Anvers, qui jouait en cinquième division, pour m’amuser… C’est à ce moment j’ai rencontré un ami qui faisait affaire dans le commerce de diamants au Congo. Il m’a dit : « Pourquoi tu viens pas à Kinshasa ? Mobutu a ouvert les frontières, il y a plein de bons joueurs à recruter, tu pourrais les mettre en relation avec des équipes »… J’ai pas hésité longtemps. C’était une bonne idée, alors je suis parti…
.Vous êtes donc devenu agent de joueur ?
Non, à l’époque, ça n’existait pas. Enfin si, mais c’était rare, il devait y avoir un ou deux managers dans toute la Belgique. En 1985, on était plutôt recruteurs. On repérait un jouer et on l’amenait dans le club où on avait des contacts, et voilà, c’était tout. Les transferts c’était rien à l’époque, 30 000 dollars en moyenne, c’était pas comme aujourd’hui. J’ai réussi à faire mon trou grâce à cet ami, qui était bien introduit dans la vie zaïroise. Il m’a présenté des gens, il m’a mis le pied à l’étrier.
.Grâce à lui, vous avez du croiser quelques beaux spécimens…
Le gars le plus dingue que j’ai jamais rencontré, il s’appelait Ado Makola. C’était un type très puissant, je crois qu’il avait épousé une des filles de Mobutu. C’était un fou, mais un vrai fou, doublé d’un mauvais type. Un voyou. Pour tout te dire, il avait le sida et il a contaminé beaucoup de femmes en le faisant exprès. On était en concurrence parce qu’il était proche de l’AS Vita. Il organisait des tournois internationaux et il vendait des joueurs à Seraing, en Belgique. Moi j’étais plus proche du DC Motema Pembe, un autre club de Kinshasa. Forcément, il a tout fait pour nous embêter. A mon époque, l’AS Vita, c’était le grand club du pays. Il fallait voir le stade Tata Raphael (ancien stade du 20 mai, ndlr) les jours de derby, c’était quelque chose ! C’était le football, oooooooow ! J’en garde un souvenir fantastique, même s’il y avait presque tout le temps des bagarres entre supporters. Les gens étaient fous ! Si tu n’as pas vu un derby de Kinshasa, tu n’as rien vu dans ta vie.
.Petit à petit, vous avez commencé à établir un réseau de correspondants qui vous signalait les bonnes affaires ?
Oui, mais je regardais beaucoup de matchs aussi. J’adorais observer les joueurs congolais, j’essayais de comprendre les spécificités de chaque région. Par exemple, les Baluba du Kasaï, ce sont des joueurs qui sont très doués, très forts physiquement. C’est là qu’est l’équipe du Sanga Balende. Les joueurs du Katanga aussi, ce sont des phénomènes. Ils sont très disciplinés. A l’époque, j’ai jamais compris pourquoi la plupart des joueurs du TP Mazembe, enfin Englebert, venaient de Kinshasa. Quand j’étais à Lumbumbashi, il y avait plein de bons joueurs mais ils partaient en Zambie pour la plupart, ils prenaient même la nationalité zambienne. Il y avait aussi des Zaïrois qui traversaient la frontière pour aller jouer au Rwanda. J’ai connu des joueurs qui jouaient le championnat rwandais le samedi, et le championnat congolais le dimanche (rires). Il faut savoir qu’au début, la plupart des joueurs de l’équipe nationale rwandaise, c’était des congolais ! Tous ! Le Rwanda n’avait pas de joueurs de qualité sous l’ancien pouvoir Hutu. C’était encore le paradis hein, c’était avant le génocide.
.
On sent à vous écouter que c’était une époque assez folklorique…
J’ai eu pas mal de belles histoires. Une fois, j’avais repéré un joueur là-bas, il s’appelait Mandiangu. Je l’ai amené au KSK Hasselt, mais il pleurait parce que sa femme était restée au pays. Bien entendu, j’accepte de l’aider. Il m’explique alors qu’elle habite à Mbanza Ngungu, une localité du Kongo – Central. C’est pas loin de Kinshasa, le long de la ligne de chemin de fer Matadi-Kinshasa. Il y a des collines, c’est un climat très spécial, très agréable. Du coup, je prends la voiture et je finis par retrouver la famille après plein de péripéties. Malheureusement, sur place, on m’apprend que Mandiangu n’a pas payé la dot ! Je demande alors ce qu’il faut. « Deux costumes, deux brebis, deux caisses de bière et de l’argent » (rires). C’était toute une histoire. J’avais pas d’argent sur moi, alors je leur ai dit qu’on réglerait la situation à Kinshasa la semaine d’après. En attendant, j’ai tout préparé, on a fait le passeport de la dame à l’ambassade. C’était un mercredi, je m’en souviens. Toute la famille est venue, j’avais l’argent, j’ai payé, ils sont partis chercher la fille et tout est rentré dans l’ordre. En deux jours, sa femme était dans l’avion.
.Pour les visas, c’était visiblement moins compliqué qu’aujourd’hui…
Oui. Dans le temps c’était assez facile de faire venir les joueurs, si tu étais considéré sérieux. Nous, on avait une bonne réputation, on avait un mec à l’ambassade qui nous aidait. Après, ça n’empêchait pas les surprises. Il m’est arrivé une histoire rocambolesque avec Roger Lukaku, le père de Romelu.
.Qu’est-ce qui s’est passé ?
A la base, j’ai repéré Roger quand il jouait pour le DC Motemba Pembe. Je me suis dit que c’était un bon joueur, j’avais tout réglé pour qu’il vienne en Belgique. Mais un jour, le président du club m’appelle, « Ah Karel ! S’il vous plaît on m’a volé mon joueur ! »… Après enquête, il s’est avéré qu’il était parti avec Simplice Zinsou, le président de l’Africa Sports. En gros, Zinsou est arrivé à Kinshasa, il a mis Lukaku sur un bateau, lui a fait traverser le fleuve et il est parti avec lui sans passeport, sans rien ! Le joueur a disparu du jour au lendemain. Faut comprendre : quand un homme de la trempe de Zinsou te contacte, c’est difficile de refuser. C’était le beau-fils deFélix Houphouët-Boigny ! A l’époque, l’Africa sports, c’était une grande équipe, c’était un honneur de jouer pour eux en Afrique. Je dis au président : « bon écoute, la seule chose qu’on peut faire, c’est aller le chercher ». Je prends l’avion pour Abidjan. Entre temps, le club m’envoie son passeport. En Côte d’Ivoire, j’engage une fille qui s’appelait Sidonie. Elle travaillait à la réception de mon hôtel. Je lui demande de chercher Roger car je ne pouvais pas m’approcher des terrains d’entraînement de l’Africa (rires) Donc je suis resté prudent, dans ma chambre. Au bout de trois ou quatre jours elle a réussi à le contacter, elle lui a dit « il y a un monsieur qui veut te voir », et ils sont venus dans ma chambre. Quand il m’a vu, il était vert ! (Rires). Je lui ai expliqué que malgré ce contre-temps son transfert n’était pas compromis. « Si tu veux, je te fais le visa et on part le plus vite possible ». On est allés ensemble à l’ambassade de Belgique d’Abidjan et il est parti. Il a joué au FC Boom. Au début ça marchait pas et puis il a commencé à marquer et il a fait une belle carrière.
.Pourtant, son fils a raconté dans une belle tribune qu’il avait eu une enfance très difficile à la maison, car son père ne gagnait pas beaucoup d’argent…
Il gagnait pas mal à Boom. C’est après sa carrière qu’il n’a pas bien géré ses affaires… Mais c’était un monsieur.
.En ce qui vous concerne, vous avez plutôt bien géré les vôtres en tant que recruteur…
Oui, mais j’ai vite arrêté, parce que ça ne me plaisait pas ce métier, il y avait beaucoup trop d’histoires. Chaque transfert était épique. J’ai vécu des choses incroyables. On en rigole avec le recul, mais avant il fallait pratiquement te mettre à genoux devant les clubs pour ramener un joueur et le caser avec un salaire minimum. Et après, quand ça marchait, d’autres agents en Europe contactaient le joueur, lui faisaient miroiter un gros salaire, et il t’abandonnait. Moi j’avais jamais de contrat avec un joueur, ça n’existait pas. Comme j’étais la plupart du temps en Afrique, je me suis fait arnaquer pas mal de fois. C’est pourquoi j’ai commencé à bosser avec le Feyenoord à partir de 1995, et qu’on a monté l’académie ensemble… Avant ça, j’ai été un peu partout, au Sénégal, en Ethiopie.
.
Qu’est-ce que vous faisiez en Ethiopie ?
Je connaissais bien Jean-Claude Mouchot, le recruteur de Guy Roux. J’allais dîner chez lui de temps en temps à Auxerre, sa femme faisait vachement bien les escargots et les oeufs aux meurettes. A l’époque, Guy Roux voulait recruter un Ethiopien et il est parti avec moi. Au début des années 90, l’Ethiopie, c’était dangereux ! Il y avait des attentats de partout… Beaucoup de régions faisaient sécession, il y avait le front de libération de l’Oromo, le Front de libération du peuple du Tigray… Les contrôles de police étaient sévères et fallait faire attention dans quel hôtel tu dormais ! Bref, on a réussi à amener un jeune à Auxerre – j’ai encore la photo – mais il n’a pas percé en équipe première. Il a joué à Bastia ensuite. Les Ethiopiens, vraiment, c’est bizarre. Quand tu vas voir des matchs sur place, ce sont des joueurs techniques, ils ont de la qualité. Mais dès qu’ils quittent leur pays ça marche pas, ils ont beaucoup de nostalgie. Déjà, il faut dire une chose, c’est qu’ils regardent leur montre à l’envers ! Quand tu leur donne rendez-vous à 14h, ils se pointent à 19h. En plus de ça, ils ont leur propre langue, leur propre calendrier avec un treizième mois qui est constitué de cinq ou six jours. Bref, ils ont du mal à s’adapter. Moi, j’ai eu beaucoup de problèmes avec les Ethiopiens, notamment à Lokeren.
.À l’époque, la presse belge a parlé de ces transferts avec des termes forts comme « marchands d’esclaves » et « traite d’être humains ». Comment avez-vous vécu cette période ?
Très mal, on m’a traité de négrier ! On m’a sali ! Heureusement, le président de Feyenoord me soutenait : « Karel, je sais qui tu es, laisse passer la tempête ça va aller ». J’ai jamais trop réagi à tout ça non plus. Nous on traitait bien les garçons, ils étaient bien soignés. On faisait beaucoup plus que les agents font aujourd’hui. On s’occupait du visa avec l’ambassade, quand le joueur arrivait je l’amenais à l’institut tropical… On faisait le travail du club en réalité ! Et on payait le voyage en plus. Bref, ces transferts à Lokeren ça a fait toute une histoire. Le fond du problème, c’est que le joueur ne s’acclimatait pas bien. Le président voulait le faire partir avant la fin de son contrat, et le joueur ne voulait rien savoir. Du coup, Lokeren a falsifié les papiers du garçon, ils ont dit qu’il n’y avait pas de contrat, alors qu’il avait été notifié à la fédération. Une ONG s’en est mêlée, ils ont porté plainte contre nous et ils ont alerté le sénateur Jean-Marie Dedecker, qui en a fait tout un scandale. Moi je n’avais rien à me reprocher, j’avais la conscience tranquille. C’est Lokeren qui n’a pas respecté ses engagements. Le président a été condamné, il a chopé du sursis. Moi, j’ai été acquitté et le joueur a reçu des indemnités. Très honnêtement, c’était beaucoup de bruit pour rien. Tous les jours, il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent dans le monde du football.
.Pour en revenir à votre académie, quel est le joueur qui vous a rendu le plus fier ?
C’est difficile à dire. Le plus fort, comme je vous l’ai dit, c’est peut-être Christian Atsu. Mais il y a aussi Solomon Asante, qui a joué au Tout-Puissant Mazembe, Harrison Afful qui a joué à l’Espérance de Tunis. Plus récemment, on a envoyé Majeed Ashimeru et Gideon Mensah à Salzbourg. Bref, il y a beaucoup de destins différents. Après, si on parle de critères personnels, celui qui m’a rendu le plus heureux, c’est Nana Asare. C’est un latéral gauche qui n’a pas réussi à percer au Feyenoord… Il était très déçu mais par la suite il est devenu capitaine dans toutes les équipes où il est passé, que ce soit à Malines, à Utrecht ou à La Gantoise. Il n’y a pas de hasard. C’est quelqu’un de droit, un exemple pour tous joueurs professionnels. Cela fait maintenant quinze ans qu’il est en Europe, il est bien. Je l’ai au téléphone de temps en temps. Il a pas beaucoup de sélections avec les Black stars mais c’est parce qu’il a refusé de jouer en sélection. Il trouvait que c’était n’importe quoi, l’organisation. Ils lui ont fait un sale coup, une fois, à Kumasi. Il devait jouer mais comme il y avait des recruteurs d’une équipe suisse en tribunes ils ont mis le latéral droit à sa place et lui n’était même pas sur le banc… Il est venu pour rien, il a trouvé ça très humiliant. La fédération l’a appelé plusieurs fois après ça, mais lui n’a plus jamais voulu revenir… (Il regarde sa montre l’air inquiet)
.Vous devez partir ?
Théoriquement, j’ai rendez-vous. Mais bon tranquille, on a encore un peu de temps. Au pire, je serai un peu en retard. Je considère plus ça comme une interview. Vous voulez un autre verre ? Allez oui. (Au serveur) Il y a du jus de mangue?
.
Vous allez sur vos 70 ans. Vous n’avez pas envie de passer la main ? Qu’est ce qui vous pousse encore à continuer ?
Qu’est ce que je vais faire d’autre ? J’aime le métier de formateur, c’est un beau métier. J’ai ma maison au Ghana. J’ai ma famille, ma femme, mon fils. En ce moment il est en train d’étudier en Belgique, il fait un masters de business et de marketing. Il n’a que 22 ans. J’aimerai bien qu’il prenne ma succession à la tête de l’académie, mais je ne le force pas. C’est un métier très dur. Enfin pas très dur, faut pas exagérer, mais c’est fatiguant parce que tu es confronté tout le temps avec la misère. Les familles souffrent, elles n’ont rien. Même pour venir au centre on doit payer le transport aux gamins. Moi, ma fierté, c’est que j’ai aidé beaucoup de gens dans ma vie. J’ai payé les loyers des parents, j’ai envoyé des jeunes à l’étranger. Grâce à moi ils ont pu gagner un bon salaire et aider leurs proches.
.Je me trompe ou je sens chez vous une fibre de gauche ?
Vous ne vous trompez pas. Moi j’ai fait 68 ! Quand j’étais jeune, j’étais très engagé. J’étais assez proche des idées de Kris Merckx, un des fondateurs du PTB, le parti du travail de Belgique. C’était un sacré maoïste, on le surnommait « le docteur » parce qu’il voulait offrir à tout le monde une médecine gratuite de haute qualité. C’était le bon temps mais c’était chaud, hein ! Chez moi, à Anvers, quand tu lisais De rode Vaan (ndlr, ancien journal du parti communiste en Belgique) tu étais presque mort (rires). Mes premiers émois politiques c’était pendant le Leuven vlaams (ndlr, l’affaire de Louvain). C’était une crise qui concernait la flamandisation de l’Université catholique de Louvain. A l’époque, la bourgeoisie parlait français et les nationalistes flamands étaient contre. Ce truc communautaire, je comprenais pas. Dans la foulée, il y a eu mai 68. Cela n’a pas trop duré, seulement quelques mois. Heureusement que ça a existé quand même. C’est bien d’être un peu social dans la vie. Quand tu es jeune, il faut s’occuper de l’injustice.
.Et depuis ?
Je me suis adouci. J’ai réalisé ça en voyant que j’aimais bien François Hollande, surtout pour son humour. Après, c’est une fatalité, on se droitise un peu en vieillissant. Il n’y a qu’à voir André Glucksmann, Alain Finkielkraut, Daniel Cohn Bendit… Comme le disait Churchill, si tu n’es pas de gauche à 19 ans c’est que tu n’as pas de coeur, mais si tu l’es encore à 40 ans, c’est que tu n’as pas de cerveau. (rires)
.Vous êtes-vous senti parfois en décalage dans le milieu du foot ?
C’était parfois paradoxal (rires) Après il ne faut pas non plus oublier qu’à l’origine, le football était un sport de gauche. C’est devenu un business seulement à la fin des années 80, avec l’apparition des agents. Avant, le peuple jouait grâce au sponsoring du président de club. C’était le notaire du village ou le patron de l’usine qui payait tout. C’était comme ça quand je jouais.
.La Belgique ne vous manque pas ?
Non, je n’y retourne presque jamais. Maintenant, quand je viens en Europe, je vais à Paris. C’est mieux. J’ai encore des amis avec qui je peux jouer au bridge. C’est un jeu vraiment passionnant, qui demande beaucoup d’efforts au début.
.Qu’est-ce que vous appréciez dedans ?
Tout ! Le contrat, le calcul, la défense… Quand tu joues avec le mort, il faut tout calculer, c’est difficile. Mais jouer avec un partenaire c’est bien aussi, parce que si tu commets une faute tu peux l’accuser. Avant, on avait un super club qui donnait sur le parc Monceau, mais il a fermé. On jouait de 14h à 20h puis on allait manger dans les jardins du parc. Il fallait aller vite pendant la pause sinon tu n’avais pas de place à ton retour ! On restait jusqu’à six, sept heures du matin.…C’était le bon temps. Aujourd’hui, c’est à peine si tu trouves assez de gens pour faire deux tables. Les jeunes préfèrent le poker….
.Tout fout le camp…
Heureusement, il reste encore la gastronomie. Sur ce plan, je le concède, j’ai des goûts de luxe. J’ai fait tous les deux ou trois étoiles de Paris. Depuis 25 ans, je vais souvent manger chez Déssirier, place du Maréchal juin, dans le 17e. J’adore les huitres et ce qui est bien, là-bas, c’est que tu as vraiment le choix. Ils ont les meilleures de la capitale. En Afrique, on en trouve parfois, mais bon, c’est pas des gillardeau ou des perles impératrices…
.Niveau nourriture, vous faites comment au Ghana ?
Je suis obligé de tout importer. Je me fais livrer chaque semaine des pigeons, de l’agneau et de la viande d’Aubrac… Du pain Poilâne et des huîtres aussi. J’ai tout ce qu’il faut, je suis pas malheureux (rires)
.Jamais de plats africains ?
Si, il y a des trucs pas mal. J’aime bien le Red Red, c’est un plat local à base d’alloko avec des haricots blancs, c’est très bon et très copieux. J’aime bien l’Attiéké aussi, surtout, avec des pintades grillés. Si vous venez diner à la maison un jour, je vous ferai goûter.
.Volontiers…
On arrosera ça d’un coup de Meursault, compte Lafont 2009-2010. Ou du Puligny si vous préférez, des grands crus quoi. La plupart du temps maintenant je bois du Chablis. Guy roux m’a donné des bouteilles de Grenouilles, c’est du premier cru, ça va bien avec les huîtres… Bon, ça me donne faim rien que d’en parler. Je vais repousser mon rendez-vous. Il y a un restaurant ici à Abidjan qui s’appelle le Jardin gourmand. Le cuisinier est un vieux monsieur originaire de Beaune. C’est pas gratuit, mais il a une cave de vins de Bourgogne absolument dingue. On peut aussi aller chez son fils, qui tient la Route des vins en zone 4. Il a des fromages importés de France et il fait un très bon saumon fumé. Je crois qu’il a aussi du saucisson de Lyon et des lentilles vertes du Puy. Cela vous plaît comme menu ?
.C’est pas mal, oui…
On pourra continuer la discussion là-bas. Grimpez dans ma voiture, c’est moi qui invite !
Tout propos recueillis par CG et JD.
Retrouvez la première partie de l’interview juste ici.